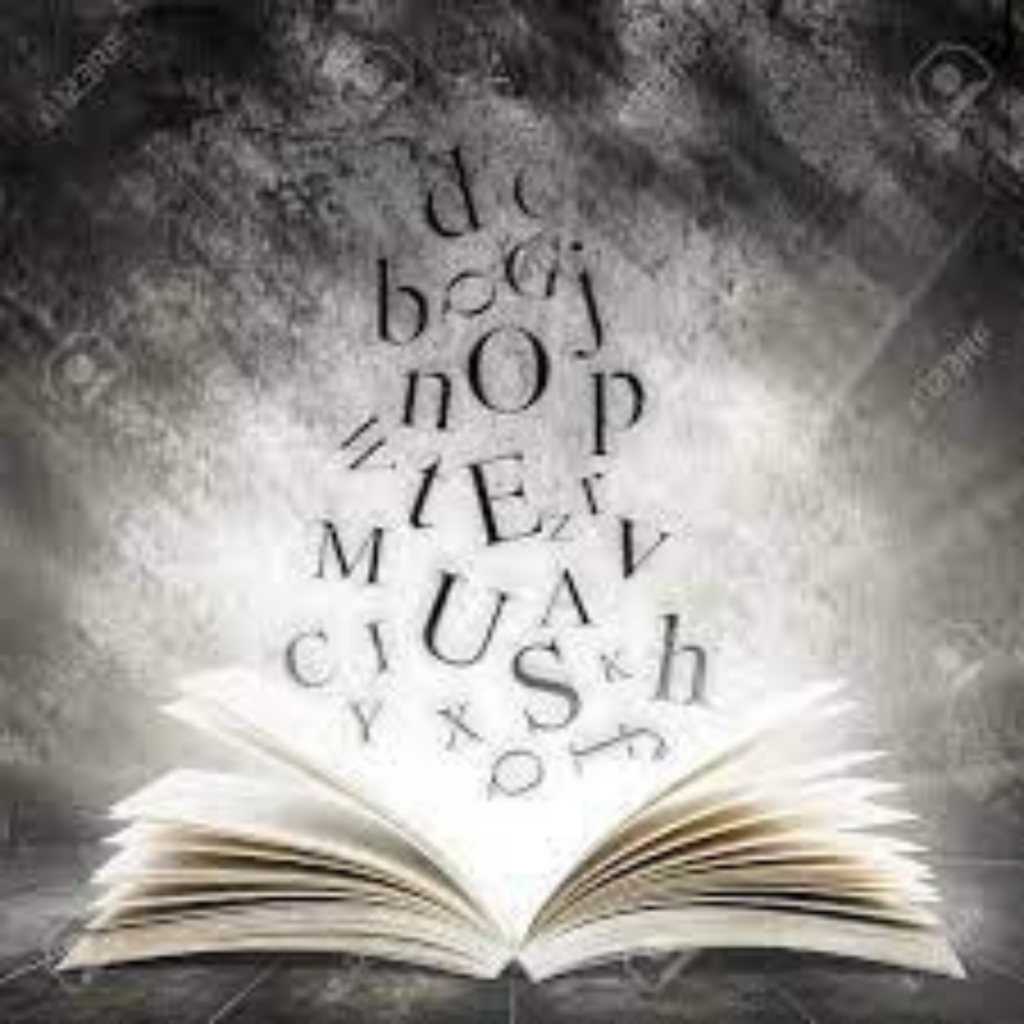tu écoutes le podcast ci-dessous :
ou tu lis l’article :
Notre société met de l’importance sur l’accès au savoir, ce qui en soit semble une bonne chose ; cependant accéder au savoir peut avoir des conséquences bien différentes en fonction de notre état d’esprit.
Le savoir fait progresser mais au final peut faire évoluer ou limiter.
Dans ce dernier cas, il peut devenir un réel obstacle dans la façon dont nous allons vivre les expériences futures.
Ainsi, le savoir influencera et limitera nos explorations et la façon de vivre la nouveauté.
Bien sûr, ici, le savoir en question n’est pas à remettre en cause. Ni la qualité de ce savoir mais plutôt la façon dont nous utilisons ce savoir et ce que cela entraine dans notre mode de fonctionnement.
Comment et dans quel état d’esprit sommes nous après avoir eu accès au savoir ?
Savoir = évolution ? limitation ?
Nous allons, pour simplifier, envisager 2 modes de fonctionnement sachant que dans la réalité tout est nuancé.
Le savoir = limitation
Tout d’abord, l’accès au savoir peut dans certains cas nous amener à une forme de satiété non évolutive. C’est-à-dire que le savoir est intégré, digéré, il fait progresser et au final ne sera pas remis en question.
S’il s’agit du savoir d’un métier, nous allons répéter toute notre vie le savoir d’origine, sans le remettre en question ou très peu et sans l’adapter ou très peu à l’évolution de la société et à différents progrès.
Ainsi, par exemple, nous avons appris une technique et machinalement, de jour en jour, nous la répétons, et cela nous permet d’être dans une sorte de confort non dérangeant.
Dans ce cas, le savoir est limitant et ne fait pas évoluer, avec cette notion statique.
Il est rassurant car il donne l’occasion de briller d’une connaissance ou d’un statut.
Le savoir = évolution
Ensuite, le savoir si il est constamment remis en question, permettra la progression. Il y a une notion de dynamique. Nous sommes ouverts à une information nouvelle qui peut-être, remettra en question notre savoir et nous entraînera dans une zone d’inconfort. C’est une forme d’ouverture d’esprit.
Et dans le golf, comment est vécu le savoir ?
Lorsque l’on est élève au golf, dès que l’on commence à atteindre un certain niveau, que l’on maîtrise un peu ce que l’on fait et que cela marche, on éprouve un sentiment » d’avoir compris » . Mais dès que l’élève commence à savoir, il ne peut plus apprendre car ‘’il sait’’
Résumons : celui qui sait, ne peut plus apprendre, parce qu’il sait
En effet, si l’élève ne remet pas en question sa connaissance tout le temps, s’il n’essaie pas d’oublier, alors il ne peut pas avancer.
Mais comment avancer ?
Un élève doit faire. Faire c’est être un récipient et recevoir.
Le pro va vous donner des indications pour faire ce que vous ne savez pas faire.
Et si vous êtes en mode ‘’récipient’’ vous pourrez recevoir l’information. De là découlera, à terme, la confiance en soi.
Le problème qui peut arriver, c’est l’orgueil de réussite » j’y suis arrivé ’’, ’’ je vais y arriver ’’, ‘’ je vais gagner ’’, ‘’j’ai la confiance’’… des » je, je ,je… » qui entravent l’évolution, voire la freinent.
La société renvoie quelque chose de négatif à celui qui ne sait pas. Or il est bon de ne pas savoir.
Celui qui sait fait fonctionner sa tête en circuit fermé, limité, il est beaucoup dans la réflexion.
Mais lorsqu’on se débarrasse de la réflexion, de toutes nos sources d’erreur alors on rentre dans la déduction, conseil clair, limpide et c’est cela qui donne des résultats.
Nous pouvons faire une analogie avec l’eau stagnante en comparaison à l’eau d’une rivière. Il s’agit toujours d’eau mais la seconde est renouvelée, ses minéraux sont différents, elle se nourrie.
En réalité, l’approfondissement, la prise de conscience… donnent des résultats mais certainement pas la réflexion.
Eric, le pro vous dira en leçon, ‘’la réflexion bloque l’action’’. Oui, la réflexion entraîne des formulations telles que 1+1 ça fait donc…. Le DONC qui vient du savoir est limitant.
La déduction idéale se fait de la situation elle-même et non du savoir ( qui est du stockage d’information ).
Il est nécessaire que la déduction se fasse sur le terrain, dans la situation, elle ne se fait pas par de l’analytique.
La déduction se fait par du vécu, par de la connexion et c’est à ce moment que le conseil clair et limpide arrive à vous.
Certains disent qu’il est bon de croire en tout sans vérifier. Car en croyant en tout, on touche forcément sur ce qui est bon, juste, sur la vérité, ainsi le moins bon, le mensonge, le faux s’élimine de lui-même.
Car un principe dit que le moins bon s’élimine de lui-même quand on touche au bon pour soi.
Et vous, qu’en pensez vous ?
Merci de votre lecture !
P.S. : N’oublions pas qu’en pédagogie, le but (idéal) n’est pas de la rétention d’information mais de déclencher un déclic.
En effet, l’impact est plus recherché que la rétention d’information.
Le but n’est pas forcément de transmettre de l’information mais de créer un impact, pour qu’en sortant, ce soit mis en œuvre.